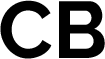
Close
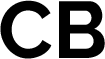
François Michaud. « Christine Barbe, Rêves de Rébellion ». 2018
Conservateur à la Fondation Vuitton.
Je me rappelle notre première rencontre. Anne Kerner m’avait proposé que l’on se retrouve dans l’exposition de Christine Barbe, il y a six ans je crois. Puis d’autres expositions ont suivi, d’autres rencontres à des moments parfois imprévus, comme si un lien magnétique nous avait retenus alors. De ces souvenirs remontent des images fugaces, évanescentes, desquelles émanait une grande force – force d’affirmation et, pourrais-je dire, d’opposition. Il y avait en tout cela comme une étrange conduite intérieure, un chemin que l’artiste a parcouru depuis longtemps mais dont ne se révèle, pas à pas, que les traces qu’il lui paraît devoir laisser – transitoirement toujours. Une exposition est une rencontre et, pour tout artiste, la projection que l’on propose de soi à travers ses œuvres. Celle-ci n’est perceptible et ne peut être reçue que dans les conditions d’écoute que le travail exige. Si l’on n’entend pas, si l’on ne voit pas, qu’importe. Mais les traces demeurent. Je crois que Christine Barbe sait cela et en a intégré depuis longtemps les conséquences. Elle travaille la disparition autant que l’apparition.
Je l’ai connue d’abord comme photographe, puis à travers ses vidéos ; mais toutes ces œuvres, qu’elles soient photographiques, numériques et en mouvement, peuvent presque pour elle s’appeler des peintures. Est venue ensuite la révélation des tableaux proprement dits (que j’ai connus à nouveau par des photographies…) nous rappelant que, dans son parcours, le médium le plus traditionnel – comme on le croit du moins – avait conservé sa place. Ils se disent peintres, ils se disent photographes… tel était le titre d’une exposition célèbre de l’ARC, au Musée d’art moderne de la Ville de Paris, qui interrogeait au début des années quatre-vingts les pratiques, nouvelles alors, de certains moyens de reproduction photographiques employés par des artistes qui ne se disaient pas tous photographes. Elle est l’une d’entre eux. Elle était trop jeune pour faire partie de l’exposition, mais à travers son travail c’est cette réflexion-là qui se poursuit, une quête de l’image qui emploie tous les supports et ne recule devant aucun. Je ne parlerai pas d’une œuvre en particulier, je parle de ses œuvres, telles que je les perçois dans un continuum qui se poursuit d’exposition en exposition – mot de la photographie. On ne rapproche jamais les deux sens de ce mot, alors qu’en français, on ne dit pas exhibition pour dire qu’un artiste montre son travail, on dit qu’il s’expose – comme on dit de la surface sensible de la photographie argentique qu’elle est exposée à la lumière. En français « exhibition » a un sens tout autre, impudique : l’homme ou la femme qui s’exhibe est quelqu’un qui se dénude. Or, il me semble que dans tout le travail de Christine Barbe, ce dénuement volontaire, cette exposition à la lumière et au regard du spectateur, du viewer, est profondément ancré. Il en va d’un certain excès, qu’elle assume – lorsque c’est son visage qui se montre, cheveux écartés, tendus comme les cheveux-serpents de la Méduse des Anciens. Cheveux-serpents étirés comme des éclairs électriques. Lumière encore. Être lumière.
Être lumière ou ombre, se retrouver près du fond, flottant entre deux eaux. Ce n’est plus Méduse mais Ophelia, et pourtant l’être qui flotte ainsi n’est pas moins exposé au regard. Ce corps qu’on peut croire sans vie ne retient de notre attention qu’un inquiétant sentiment d’étrangeté. Les images de Christine Barbe nous semblent familières et nous dérangent à la hauteur de leur évidence. L’être qui se montre, en photo, vidéo et peinture est à la fois un corps animé et plus qu’un corps – ou moins qu’un corps. Il est dans l’au-delà. Pourtant elle le retient avec force. Nous n’aimons voir ni les cadavres ni les fantômes ; aussi les siens ne sont-ils que des illusions dues aux procédés de l’art. Je pense à l’instant à cet art de plus en plus lointain qu’est celui du vitrail. N’y a-t-il pas quelque chose de cette antique présence, évidente aux yeux des bourgeois qui se massent dans les cathédrales gothiques, des paysans qui affluent vers la ville durant les jours de foire – et qui viennent voir, ébahis, la réalité de ce que leur ont compté les prêtres, les mères et les grand-mères depuis le temps de leur enfance ? Les pères aussi parfois.
Et ils voient. Croient-ils ? Croient-ils aux saints, aux évêques, aux rois et à la Vierge qui peuplent les baies de leurs églises ? Christine Barbe, se présente ainsi à son tour, dans un cadre qui peut être celui de l’écran digital comme de la photographie retouchée sous sa vitre, peinte avec les moyens que nous avons, nous autres modernes. Elle ne se dit pas peintre, elle ne se dit pas photographe, mais elle dit ses rêves de rébellion – rêve peut-être d’un retournement de situation : que la présence absente devienne une vraie présence, en faisant voler en éclat la surface. Si elle emprunte ce détour de l’expression frontale, verticale, souvent hiératique, propre aux figures des vitraux qu’elle a vus comme nous tous, ce n’est certainement pas pour se montrer telle une sainte. Le renversement de valeurs esthétiques s’éclaire soudain : oui, elle est bien là, elle-même, non comme un fantôme mais comme la trace photographique ou picturale de son être ; or, c’est la même chose, car cela nous montre une picture, une image. Et cet être, il peut hurler bien qu’il soit calme, paisible dans son cadre d’œuvre d’art ; il peut nous regarder bien qu’il ne puisse nous voir ; il peut nous parler bien qu’il soit silencieux. Il peut dire son désir, et son rêve de révolte. L’art est violence, car il est destruction d’une matière, remplacement du vide par de l’autre. Et l’artiste devient autre.
L’artiste devient paysage, les visages se sont effacés, le corps disparaît. Cela se dissout, mais pour découvrir une tout autre matière, des lieux sans horizon mais qui ne sont pas bouchés, des lieux que l’on pourrait dire accueillants et habités – bien qu’il n’y ait personne… La présence de l’auteur baigne ses arbres, ses clairières, ses rivières que désormais elle contemple d’un peu haut, comme depuis le sommet d’une colline. Un nouvel espace s’est créé – un espace mental et pourtant très réel. Il est venu de la contemplation du travail des forestiers : déplacement d’énormes masses de terre prise dans les racines ; arbres déracinés, terrassements, dont le résultat est le calme de ces toiles, mais aussi la présence de la taupe, nouvelle compagne, comme un être similaire à l’artiste qui est là, invisible, sous le paysage – et qui creuse, et qui transforme. La photographie n’est pas oubliée, elle est partie prenante de ces nouveaux tableaux que Christine Barbe nomme Là-bas/Down there. Là-bas, il y a quelqu’un, mais qui cette fois nous regarde mieux encore que par le passé. L’artiste a su se dégager d’elle-même, de son corps et de son image, et se mettre à faire véritablement, à construire, à produire un espace propre et une matière détachée de soi, un paysage hors-sol et pourtant habitable. Où l’on se plaît à demeurer.
François Michaud, 5 juillet 2018, l’après-midi
Conservateur au Musée d’Art Moderne de la ville de Paris
François Michaud. « Christine Barbe, Dreams of Rebellion ». 2018
Curator at the Vuitton Foundation.
I remember our first encounter. Anne Kerner had suggested meeting at Christine Barbe’s exhibition, six years ago if I’m correct. Then more exhibitions followed, more encounters, sometimes unexpected ones, as if a magnetic connection had then held us back. Fleeting and evanescent images resurface from these memories which conjured up a great force of affirmation, and if I may say so, of opposition. There was in all of this something of a peculiar inner conduct, a path that has been followed by the artist for a long time but which reveals, step by step, only the traces she thinks she has to leave — always transiently. An exhibition is an encounter and, for any artist, the projection of what they offer of themselves through their artworks. The former can only be perceived and received under the right listening conditions required by the work. It doesn’t matter if we do not hear, if we do not see. However the traces remain. I think Christine Barbe knows this and integrated its consequences a long time ago. She works disappearance as much as she does appearance.
I first knew her as a photographer, then by way of her videos; yet to her all of these artworks could almost be defined as paintings, whether they be photographic, digital and in motion. Then came the revelation of the actual paintings (which once again, I came to know through photographs…), reminding us that in her journey, the most traditional meduim — at least as we see it — had retained its place. Ils se disent peintres, ils se disent photographes… was the title of a famous early eighties ARC exhibition at the Museum of Modern Art in Paris, examining the then new practices of certain means of photographic reproduction used by artists who did not all identify as photographers. She is one of them. She was too young to be part of the exhibition but that reflection is continued through her work, it is a quest for images that will use all formats available and retreat before none. I will not write about one artwork in particular, I write about her works the way I perceive them within a continuum that goes on from exhibition to exhibition (translator’s note: the French for ‘exhibition’ is exposition which can also mean ‘exposure’ in the photographic meaning of the word) — a photograpy term (t/n: in French). The two meanings of the French word exposition are never linked together: the French language does not use exhibition to describe an artist showing their work (t/n: exhibition in French may be used as the English ‘exposure’ in a negative sense), but rather that they expose it — just as we would use the word to describe the sensitive surface of analog photographs when they are exposed to light. In French, “exhibition” (see above) has a completely different, immodest, meaning: the man or woman who exposes (t/n: exhibe themselves in French) themselves is someone who takes their clothes off. Yet, it seems to me that in all of Christine Barbe’s work, this intentional bareness, this exposure to light and to the gaze of the audience, of the viewer (t/n: in English in the French version of this text), leaves a deep mark in her approach. It makes for a certain excess that she accepts — when her face is showing, her hair brushed aside, stretched like snake-haired Medusa. Snake hair stetched like bolts of lightning. Light, again. Being light itself.
Being light or shadow, finding yourself near the bottom, floating near the surface. It is no longer Medusa but Ophelia, and yet, the being who floats like this is not less exposed to the gaze. This body which we may think of as lifeless only gets a disturbing feeling of strangeness out of our attention. Christine Barbe’s images seem familiar and disturb us just as much as they are obvious. The being on display in photographs, videos and paintings is a body that is both animated and more than a body — or less than a body. It is in the afterlife. Yet she strongly holds on to it. We don’t like to see corpses or ghosts; hers are only illusions created by the processes of art. I instantly think about the increasingly distant art of stained-glass. Isn’t there something of this ancient presence, obvious to the bourgeoisie who gather in Gothic cathedrals, to the peasants who converge into the city during fair days — and who come to see, astounded, the reality of what priests, mothers and grandmothers had been telling them since their childhood; sometimes also fathers? And they see. Do they believe? Do they believe in saints, bishops, kings and the Virgin Mary who fill the windows of their churches? This is how Christine Barbe introduces herself, in a framework that can be that of the digital screen or the retouched photograph under its glass, painted with the means that we modern people have access to. She identifies neither as a painter nor as a photographer, but she does state her dreams of rebellion — maybe she dreams of a shift in the situation: the absent presence becoming a real presence, by smashing the surface. Even though she takes this detour of frontal, vertical, often aloof expression, specific to the characters in stained-glass windows that she, and all of us, did see, it is certainly not to paint herself as a saint. This reversal of aesthetic values suddenly makes sense: yes, she is there, her own self, not as a ghost but as the photographic or pictorial trace of her being; yet it is the same thing because it shows us a picture (t/n: in English in the French version of this text), an image. And this being can scream even though they are calm and peaceful in their setting as a work of art; they can watch us even though they can’t see us; they can speak to us despite their being silent. They can tell their desire and their dream of revolt. Art is violence because it is destruction of matter, it replaces nothingness with otherness. And the artist becomes other.
The artist becomes landscape, faces have faded, the body disappears. It gets dissolved in order to reveal a brand new substance, places with no horizon but not obstructed, places that could be described as welcoming and inhabited — although there is no one there… The presence of the author pervades its trees, its clearings, its rivers that she now contemplates from slightly higher up, as if standing on the top of a hill. A new space has emerged — a mental yet very real space. Anne Kerner told me this morning that it came from contemplating the work of forest rangers. The shifting of huge masses of earth stuck in roots. Uprooted trees, levelling, the result of which lies in the calm of these paintings but also the presence of the mole, a new companion, like a being similar to the artist that is there, invisible, under the landscape, digging and transforming. Photography hasn’t been forgotten, it has a stake in these new paintings which Christine Barbe called Là-bas/Down there. Down there, there is someone, but this time, they look at us better than in the past. The artist has managed to free herself from herself, her body and her image, and has started to truly make, build and produce a specific space and substance detached from the self, a soilless yet habitable landscape, where we like to dwell.
François Michaud, July 5, 2018, afternoon
Curator at the Museum of Modern Art of the City of Paris