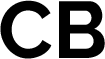
Close
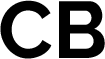
Anne Malherbe. « Christine Barbe ou la possibilité du territoire ». 2018
Docteur en histoire de l’art, critique d’art et commissaire d’exposition.
Tenter un chemin, être déséquilibré par les accidents du terrain, buter sur du matériel de chantier, être arrêté par des branchages, se prendre les pieds dans un entrelacs de tuyaux ou de grillages.
Ou encore : se retrouver dans un espace sans repère, espace matriciel ou espace de la conscience, clos et oppressant. Sentir son corps entravé de l’intérieur par le constat et la déclinaison de ses propres impossibilités.
L’œuvre de Christine Barbe parle de l’empêchement. Elle parle de la difficulté de s’actualiser en tant qu’être social, dans un monde auquel on nous demande d’appartenir et de participer. Elle parle aussi de la foncière inhospitalité de tout lieu dans lequel on arrive comme étranger, d’y trouver sa place et son champ de vie.
Pourtant, en dépit de l’inconfort perceptible dans ses séries les plus récentes : Lignes de flottaison, Rêves de rébellion, Là-bas / Down there, celles-ci, dans la façon dont elles sont plastiquement traitées, offrent également leur propre réponse à la nécessité de l’inscription
Inhospitalité
Là-bas / Down there (2016 – 2017), la dernière série en date, est composée de peintures de grand format. Ce sont des paysages — dans la mesure où il s’agit de vues d’extérieur dans lesquelles ne figure aucun personnage —, des zones de chantier, au milieu d’une forêt ou d’un bois.
Par leurs dimensions, les œuvres sont à la mesure même du corps. On pourrait y mettre un pied, s’y avancer, y chercher notre place. Et le premier plan, parfois marqué par une perspective très accentuée, tendrait à nous entraîner brutalement au sein des lieux, comme si on nous tirait par le col. Mais, au dernier instant, nous nous immobilisons à la lisière.
Ces lieux sont proches et lointains à la fois. Proches, parce qu’il suffirait d’emprunter ce bout de sentier qui s’ouvre devant nous et descendre le talus. Lointains, parce que la place centrale, le plan d’eau, l’architecture abandonnée, prennent de la distance à mesure qu’on avance, par un effet d’accentuation de la perspective.
Ailleurs un morceau de clôture de chantier nous barre brusquement le passage. Ou bien nous allons buter contre les rails, posés de telle sorte qu’ils menacent de basculer vers nous.
Rien ne nous invite vraiment à franchir le seuil, ni la lumière acide, ni les accidents du terrain, ni cet état de suspens dans lequel l’endroit semble s’être arrêté. Rien ne nous permet de faire corps avec le lieu. Ces lieux ne nous attendent pas ni n’ont besoin de nous, comme ces territoires que l’artiste a abordés au fil de ses déménagements, de Grenoble et Paris à la Californie et New York, en passant par des résidences en Afrique du Nord, faisant d’elle une apatride permanente, en quête de son propre lieu.
Dans ces étranges paysages (et « étranges », ici, au sens où l’on s’y sent étranger), quelque chose relève du travestissement. Sous les travaux de terrassement, les couleurs artificielles, la lumière qui n’indique aucune heure, ces lieux masquent leur identité. En les regardant, on peut penser, par leur lumière, leur mystère aussi, aux paysages de Peter Doig. Mais ceux-ci, dans un élan très romantique, semblent faits pour attiser le désir, alors que, chez Christine Barbe, les paysages se travestissent par volonté de se soustraire au désir du voyageur. Leur force particulière, c’est justement d’opposer au désir une fin de non-recevoir.
S’emparer
Même si les déplacements de Christine Barbe l’ont conduite essentiellement dans des zones urbaines, c’est une zone forestière qu’elle a élue pour ses derniers travaux. Certes, parce que c’est non loin d’une forêt qu’elle vit désormais. Mais aussi parce que la forêt offre à son travail une malléabilité toute particulière. Et puis, il y a aussi cette attention portée à la nature elle-même et à la façon dont l’humain s’est emparé d’elle. La série créature (contemporaine de celle de Là-bas / Down there) présente une succession d’animaux morts. Taupes et oiseaux, bestioles de la forêt, sont suspendus dans l’espace, comme dans les tableaux de chasse à l’ancienne. Rejetés de leur habitat naturel à cause de l’intervention humaine, ils se retrouvent cernés par un fond sombre qui est un comme non-lieu.
Il y a ainsi ceux qui s’emparent des territoires et il y a les autres. Dans Rêves de rébellion(2013 – 2016), qui est à la fois une vidéo et une série de captures d’images retravaillées, le gros plan sur le visage de l’artiste la montre répétant indéfiniment des variations sur la phrase « Je ne sais pas comment y arriver ». Elle les répète, telle une litanie obsessionnelle. Ces mots sont accompagnés d’inlassables mouvements de la tête. Elle rejette son impuissance comme une fièvre chevillée au corps.
Dans le sens premier (et désuet) du terme, le terme « désemparer » est un verbe transitif : on parle de désemparer un lieu, à savoir d’en sortir. Mais aussi de désemparer un navire, de le mettre hors d’usage. Ici, le corps a été privé de son lieu. Il n’est même plus capable de se sortir de la situation où il se trouve. Il est, à proprement parler, désemparé.
Cette expression répétée sans fin « Je ne sais pas comment y arriver » se décline en trois langues (l’anglais, le français et le néerlandais, les trois langues pratiquées par Christine Barbe) comme si, à force de les essayer toutes, comme les clés d’un trousseau, l’une des trois allait bien finir par briser le mur de verre et franchir les espaces. Mais on est dans un rêve obsessionnel. La chevelure s’y étale comme celle d’une noyée. Les inscriptions à la surface, mots et traces de couleur, sont posées telle une buée qui, implacablement, rappelle la présence de la vitre infranchissable.
Immobilité
Les travaux, dans Là-bas / Down there, sont à l’arrêt. Ni achevés, ni abandonnés, plutôt en suspens, comme si des circonstances inconnues les avaient empêchés de se poursuivre, qu’un interdit ait été émis. Les arbres sont dénudés. Est-ce l’hiver ? Rien, par ailleurs, ne l’indique particulièrement. Peut-être la nature a-t-elle seulement cessé de vivre. La lumière est électrique, avec ici ou là des ombres très marquées, ainsi dans ces moments d’attente avant l’orage.
On est hors saison, hors temps, hors mouvement, dans l’irréalité d’un moment que toute vie semble avoir déserté. On pense à ces paysages urbains et crépusculaires dépeints, à l’époque victorienne, par John Atkinson Grimshaw, lieux abandonnés avec l’arrivée du soir et la fin du travail, et dont on se demande s’ils retrouveront finalement la vie qui est censée les animer.
Cet arrêt, c’est aussi celui du corps de l’artiste. Dans la série Lignes de flottaison(2013 – 2016), il est tétanisé, ligoté dans un rêve, électrisé par la lumière issue du caisson lumineux qui sous-tend le dessin, figé dans une posture qui évoque celle d’un noyé ou d’un crucifié. Ces dessins sont en réalité réalisés à partir d’arrêts sur image prélevés dans la vidéo Balbutiements / faire face où, dans une mélopée sans fin, l’artiste fait part de sa difficulté d’exister.
Exister, dans son sens premier : se situer hors de, donc sortir de la matrice et se tenir debout dans le monde extérieur. Et peut-être, dans un premier temps, rassembler la voix et le corps qui, dans la vidéo, sont dissociés — la voix résonnant de loin, comme si, confisquée à l’artiste, elle ne résonnait plus que depuis une zone enfouie de l’inconscient. Au terrain malmené de Là-bas / Down there, répond en écho un corps gisant, que l’on a privé de l’accès immédiat à sa voix.
On pourrait situer le travail de vidéo de Christine Barbe dans deux familles distinctes. D’un côté, celle de Bruce Nauman, avec son travail sur le corps, les gestes quotidiens, les mimiques, la répétitivité. De l’autre, celle de Bill Viola, avec la façon dont celui-ci insère le corps dans un milieu aquatique au sens multiple : au-delà, inconscient, liquide amniotique, espace de toutes les virtualités et de toutes les gestations. Mais, à la différence du second, chez qui le corps s’abandonne à la confiance dans une métamorphose à venir, Christine Barbe, elle, maintient vivace la lutte à l’intérieur de ce corps dont le propos est de retrouver prise dans le monde réel. Et, à la différence de Nauman qui présente le corps, ou des fragments de corps, avec une répétitivité obsessionnelle et violente, dans le dessein de réveiller le spectateur, Christine Barbe, elle, laisse au corps, par le biais, justement, de la résistance qu’il oppose à sa situation, la capacité de modeler quelque chose de nouveau.
Arpenter / Inscrire
Quand, dans Rêves de rébellion, mots et couleurs sont inscrits sur la vitre telle une buée rejetée par la voix de l’artiste, quand le visage, par son modelé même, résiste à la pression du néant, on sait que le dépassement a été opéré. Arpenter, modeler, inscrire : tels sont les termes par lesquels le travail de Christine Barbe trouve sa signification et son dépassement.
La technique est singulière. Christine Barbe travaille à partir de prises de vue qu’elle a effectuées. Mais ces photographies, au lieu de les utiliser telles quelles, elle commence par leur faire subir découpages et transformations, avant de les agrandir puis d’en faire le substrat de ses peintures.
Elle malmène ces photographies, les triture afin qu’elles puissent rendre compte de la difficile inscription du corps. Mais c’est précisément en triturant la photographie initiale que Christine Barbe peut aussi, finalement, faire corps avec le lieu.
La formation de Christine Barbe est celle d’une graveuse. Si, aujourd’hui, elle ne grave pas, à proprement parler, son travail n’est pas non plus celui d’un peintre qui fait naître un univers sous ses pinceaux. A ceux-ci, elle préfère le rouleau et les chiffons du graveur.
Une fois agrandies, les photographies sont en effet encrées, comme on le ferait avec la plaque de cuivre, dans les entailles de laquelle l’encre s’infiltre. C’est ainsi, aussi, que l’on peut reprendre possession d’un terrain. Découper, modeler, encrer, c’est de nouveau faire sien un territoire.
Dans un travail plus ancien (Identités croisées, 1992), Christine Barbe a arpenté Paris et son patrimoine ou, plutôt, a rassemblé les traces de cet arpentage sous la forme d’une série de pavés et de morceaux de fresque. Recouverts d’une émulsion photographique, ceux-ci portent la trace fantomatique, telle une persistance rétinienne (ou un voile de Véronique), du passage de l’artiste dans ces lieux façonnés par l’homme et la mémoire. Ce faisant, elle y pose ses pierres.
Christine Barbe est performeuse, parce qu’elle arpente. Et parce que, par sa propre volonté ou malgré elle, sa vie est faite d’une permanente mobilité. Mais elle est plasticienne, dans le sens où tout son travail consiste à rendre meuble un lieu qui lui opposait d’abord sa rigidité. Plasticienne, c’est aussi ainsi qu’elle crée son propre territoire. Christine Barbe crée comme elle habite, elle crée pour habiter.
Anne Malherbe
Anne Malherbe. « Christine Barbe or the possibility of territory ». 2018
Doctor in art history, art critic and exhibition curator.
Attempting a path, losing your balance on the uneven ground, tripping over building site equipment, being stopped by branches, stumbling on an entanglement of hoses or wire fence.
Or finding yourself in a space with no point of reference, a matrix space or space of conscience, closed and oppressive. Feeling your body being hindered from the inside by the assessment and variations of your own inabilities.
The work of Christine Barbe is about being held-up. She talks about the difficulty of being up to date as a social being, in a world asking us to belong and participate. She also talks about the fundamental inhospitality of any space we enter as strangers, about finding our place and field of life.
However, in spite of the perceptible discomfort in her most recent series: Lignes de flottaison, Rêves de rébellion, Là-bas / Down there, they offer, in the way they are artistically treated, their own response to the necessity of being part of a space.
Inhospitality
Là-bas / Down there(2016 – 2017), her latest series, is made up of large size paintings. They are landscapes — in that they are outside views with no characters —, building site zones, in the middle of a forest or a wood.
Through their dimensions, the artworks are a similar size to bodies. We could step in them, walk into them, search for our place. The forefront, sometimes marked by a very pronounced perspective, may tend to brutally carry us away to the heart of the places, as if we were being pulled by the collar. However, at the last minute, we stand still at the border.
These places are both close and far away. Close because it would be enough to just follow this stretch of path which is opening in front of us and walk down the embankment. Far away because the central place, the artificial lake, the abandoned architecture, become more distant as we move forward through an effect of intensified perspective.
Elsewhere, a piece of building site fence abruptly blocks the way. Or we stumble over rails, placed in such a way that they threaten to topple towards us.
Nothing really invites us to step through, neither the acid light, nor the uneven ground, nor this unresolved state in which the place seems to have stopped. Nothing allows us to become one with the space. These spaces are neither waiting for us, nor do they need us, just like these territories that the artist approached as she was moving, from Grenoble and Paris to California and New York, through residencies in North Africa, making her permanently stateless and seeking her own space.
In these strange places (“strange” used here in that we feel as strangers there), something falls within the realm of misrepresentation. Under the grading works, the artificial colors, the light that indicates no time, these places conceal their identities. By watching them, they may remind us, with their light, with their mystery also, of Peter Doig’s landscapes. However, the latter, in a very romantic rush, seem to be made to arouse desire, whereas with Christine Barbe, the landscapes disguise themselves in a bid to escape the desire of the traveler. In fact, their particular strength is to turn desire down flat.
Seize
Although Christine Barbe’s trips have mainly taken her to urban zones, she chose a forest zone for her latest work. Admittedly she now lives near a forest. However, it is also because forests give her work a specific malleability. Then there is also the attention paid to nature itself and the way human beings have seized it. The créature series (created at the same time as Là-bas / Down there) presents a succession of dead animals. Moles and birds, forest creatures, are suspended in space, similar to old hunting paintings. Rejected from their natural habitat because of human intervention, they find themselves surrounded by a dark background which is like a non-space.
Therefore, there are the ones who seize territories, and then there are the others. In Rêves de rébellion(2013 – 2016), both a video and a series of edited screenshots, the close-up on the artist’s face shows her endlessly repeating variations of the sentence “I don’t know how to do it”. She repeats them, like an obsessional litany. These words come with tireless movements of the head. She rejects her powerlessness like a fever pegged to her body.
In its original (and dated) meaning, the French word désempareris a transitive verb: désemparera place used to mean getting out of it. Désemparera ship also meant making it unusable. Here, the body has been deprived of its place. It is no longer able to even remove itself from the situation it is in. It is, strictly speaking, désemparé, or lost at sea.
This expression, “I don’t know how to do it”, repeated endlessly, is available in three languages (French, English and Dutch, the three languages spoken by Christine Barbe) as if, through using them all like the keys of a bunch, one of them would end up smashing the glass wall and break through the spaces. But we are in an obsessional dream. The hair is spread like the hair of a drowned woman. The inscriptions on the surface, words and traces of color, are laid out like mist which acts as a relentless reminder of the impassable glass panel.
Immobility
The works in Là-bas / Down there, are at a standstill. Neither completed, nor abandoned but, more accurately, left up in the air, as if unknown circumstances had prevented them from their pursuit, as if they had been banned. The trees are bare. Is it winter? There is no clear indication that it is. Maybe nature has just ceased to live. The light is electric, with pronounced shades here and there, like these moments of waiting before the storm.
We are off-season, off-time, off-movement, in the unreality of a moment that seems to have been deserted by life. We think of those urban and crepuscular landscapes painted, in the Victorian age, by John Atkinson Grimshaw: places abandoned when evening comes and work finishes, and which make you wonder whether they will eventually regain the life that is supposed to animate them.
This standstill is also the artist’s body. In the Lignes de flottaison(2013 – 2016) series, it is paralyzed, tied up in a dream, electrified by the light coming out of the light box underlying the drawing, frozen in a position that evokes a drowned or crucified person. In fact, these drawings are created from screenshots from the Balbutiements / faire face video in which the artist, through an endless monotonous chant, shares how difficult it is for her to exist.
Here, it is existing in its original meaning: placing oneself outside of something, therefore leaving the matrix and standing up in the outside world. Initially, the voice and body may be reunited; they are separated in the video — the voice resonates from a distance, as if, taken away from the artist, it only resonated from a buried zone of the unconscious. The rough and uneven ground in Là-bas / Down there is echoed by a lifeless body, deprived of the immediate access to its voice.
Christine Barbe’s video work can be situated in two distinct families. On the one hand, that of Bruce Nauman and his work on bodies, daily gestures, mimicking, repetitiveness. On the other hand, that of Bill Viola and the way he inserts the body into multiple aquatic environments: the afterlife, the unconscious, amniotic liquid, the space of all virtualities and gestations. However, unlike the latter, where the body gives in to trust in an upcoming metamorphosis, Christine Barbe maintains the long-lasting fight within her body whose aim is to reconnect with the real world. And, unlike Nauman, who presents bodies, or fragments of bodies with a violent and obsessional repetitiveness, with a view to waking up the audience, Christine Barbe gives the body, through the resistance it sets against its situation, the ability to model something new.
Stride / Write
In Rêves de rebellion, when words and colors are written on the glass panel like mist rejected by the artist’s voice, when the face, through it very modeling, resists the pressure from nothingness, we know that a breakthrough has happened. Striding, modeling, writing: these are the terms through which the work of Christine finds its significance and breakthrough.
The technique is singular. Christine Barbe works from photos she has taken. But instead of using these photographs as they are, she starts by subjecting them to cutting out and transformations, before enlarging them and making them the foundation of her paintings.
She mistreats these photographs, fiddles with them so that they summarize the difficult inscription of the body. But it is precisely by fiddling with the initial photograph that Christine Barbe can also, eventually, become one with the space.
Christine Barbe is a trained engraver. Today she doesn’t engrave, strictly speaking, however, her work isn’t far away from that of a painter who creates a universe with their brushes. Although she prefers the engraver’s rollers and rags to brushes.
Once enlarged, the photographs are in fact inked, just like a copper plate would be, and where the ink infiltrates the notches. This is also how a plot of land can be reclaimed. Cutting, modelling, inking is to reclaim a territory as our own.
In an older artwork (Identités croisées, 1992), Christine Barbe strode across Paris and its heritage, or rather, she gathered the traces of this striding in the form of a series of cobblestones and bits of a fresco. Covered in a photographic emulsion, they bear the ghostly trace, like a persistence of vision (or a veil of Veronica), of the artist’s visit in these places shaped by humans and memory. In doing so, she lays her foundation stones.
Christine Barbe is a performer because she strides. And because through her own will or in spite of it, her life is permanently mobile. But she is a plastic artist in that her entire work consists in making moveable a place that was originally obstructive through its rigidity. It is also as a plastic artist that she creates her own territory. Christine Barbe creates just like she inhabits, she creates in order to inhabit.
Anne Malherbe