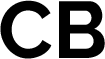
Close
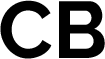
Antonio Del Guercio. « Pertes et rémanences ».
Historien de l’art. Catalogue exposition « Des rives de l’art ». Fondation Clews. Mandelieu La Napoule. 1995
« Pertes et rémanences »
Ce dont l’œuvre entière de Christine Barbe parle, ce dont son travail le plus récent offre un témoignage à l’extrême, c’est ce qu’il y a à la limite de l’indicible.
Il s’agit d’une quête ardue, à la frontière de la présence humaine, au lieu des battements subtils, des tressaillements à peine perceptibles, des regards perdus. Là où, en somme, l’expression est d’autant plus intense que les formes renoncent à tout superficiel éclat, et semblent presque s’éteindre, comme si la parole de l’art risquait à tout moment de s’effacer : donc à la frontière de l’image. La peinture, les émulsions, les reliefs, inscrivent des apparitions fragiles et dépouillées – Corps, visages, paysages, nébulosités, villes entières – sur des matériaux durs. Le béton pesant et sommaire, le métal torturé, s’animent de camaïeux de gris ou de tonalités froides et chaudes se rencontrant, s’entremêlant ou s’opposant.
Il apparaît que la variété incommensurable des situations, et des signes qui les manifestent, est ramenée au plus essentiel, à l’ultime, au terme d’une sorte de macération qui se produit dans le filtre de la mémoire et qui laisse émerger dans l’œuvre ce qui a résisté à son crible : ce qui reste quand l’engorgement des objets, couleurs, signes et symboles de la Cité spectaculaire a été brulé par la quête exigeante de l’essentiel. On ne parvient en effet à ce dépouillement que par un long processus au cours duquel le regard a engrangé toutes ces choses, et leur a donné un sens. Cette accumulation visuelle et psychologique a eu lieu, et de façon exemplaire à mon sens, dans la recherche antérieure de Christine Barbe, et tout spécialement dans ses œuvres de la seconde partie des années quatre-vingt. Des peintures révélatrices, qui ont constitué, je crois, un avant-propos nécessaire aux options récentes de l’artiste.
Un impact violent et amoureux avec la réalité urbaine y donnait lieux à un langage pictural prenant sa place du côté de celles qui peuvent être définies comme les réponses européennes -anglaises et continentales – à l’art urbain des Etats-Unis, ou plus exactement new-yorkais. Et si ces peintures révèlent une certaine affinité avec l’expressionnisme urbain de Ron Kitaj, c’est justement de l’un des rares américains (Irving Petlin en est un autre) qu’il s’agit, dont on peut dire qu’ils se sont véritablement réfugiés dans la culture picturale européenne. Christine Barbe y a interpellé du même coup les formes implosées de Jackson Pollock et la phénoménologie urbaine chère à l’art pop.
Mais ce qui distingue ses œuvres de celles des artistes pop, et qui les rend culturellement et psychologiquement autres et postérieures, c’est l’absence de toute conception de l’image comme transcription des objets et des corps tels que les moyens techniques de représentation (photo, cinéma, TV, publicité) les proposent. Ici, pas d’image de l’image, mais image fusionnant la chose et la perception de la chose. Une sorte de confrontation, ou de corps à corps serré, entre la subjectivité de l’auteur, ou même son état d’âme du moment, et l’irruption immédiate du quotidien urbain.
A la perception prévalemment statique de l’art pop américain, Christine Barbe a alors opposé un dynamisme très spécial : la surface de la toile se présentant un peu comme un écran faisant présager un changement de scène d’un moment à l’autre, de telle sorte qu’une tension s’y crée entre la persistance de l’image et son animation par le souffle qui en balaie les formes et en dilate des couleurs impensables sans l’expérience africaine de 1984. J’ai voulu dire quelques mots de cette phase particulière du passé de ce peintre, pour bien souligner que ses œuvres actuelles, « à la frontière », sont le résultat d’un travail de condensation à l’arrivée, si l’on peut dire, le dépôt essentiel et profond d’une élaboration originale des formes possibles, et d’une interrogation serrée, tout aussi originale, jamais suiviste, d’aspects importants, et problématiques, de l’expérience artistique internationale de la seconde moitié de ce siècle.
Ce n’est d’ailleurs pas par hasard non plus que le long du chemin qui l’a amenée à ses résultats actuels, elle a rencontré certaines expériences de l’art informel. Là aussi, pas de traces imitatives.
C’est, au contraire, d’une implication intense et personnelle qu’il s’agit, dans les nœuds et les conflits psychologiques et culturels où les expériences informelles, ainsi que l’art de Giacometti, ont leurs racines : malaise urbain, foule solitaire, sens de la perte des « épaisseurs » humaines, difficulté d’être.
Elle a su reconnaître en cette fin de siècle l’évolution, et donc les formes nouvelles, de la réalité urbaine dont Baudelaire comprit le premier qu’elles changeaient, de même que l’aspect de la ville, la condition humaine.
Son œuvre signale donc une perte, une diminution, conséquence de l’atteinte quotidienne à la plénitude de l’être. Mais Christine Barbe n’est pas de ceux qui n’enregistrent qu’un constat, et n’appréhendent donc que le ici et maintenant des phénomènes, sans percevoir qu’ils sont l’aboutissement d’une longue histoire se poursuivant sous nos yeux selon des lois de variation infinie. J’avais évoqué dès les premières lignes de ce texte la donnée fondamentale constituée par la mémoire, comme filtre de la relation de cette artiste au monde.
On oublie parfois que la mémoire n’est pas le souvenir : pensons aux considérations mémorables de Walter Benjamin, au cœur de ses pensées sur Baudelaire et sur Paris, à propos de la mémoire du souvenir, de l’objet-souvenir, etc…
La mémoire n’est pas fixée en effet sur un fragment de temps ou d’espace, et surtout elle ne concerne le passé que dans la mesure où il est un des éléments de l’ensemble structuré et organique passé-présent-futur.
Le temps de la mémoire est en somme un temps complexe : comme dans ces œuvres où le regard posé sur les restes, vestiges et ruines de la vie s’écoulant, produit des images et des formes dont le « tempo » n’est pas celui de l’instant, du présent restreint. Matériaux rudes et sommaires et moyens d’expression sévères monumentalisent ces œuvres, qu’elles soient à deux ou à trois dimensions. Ces monuments à la perte et à la fragilité se projettent sur un horizon actuel et archaïque en même temps. Il y a dans certaines images affleurant, légères et troublantes, sur leurs blocs durs, un côté totem qui associe leurs technicités modernes à la valeur sacrale et communautaire de la plus ancienne sculpture tribale.
Christine Barbe prend place sur un versant de l’art d’aujourd’hui qui, pour être minoritaire, n’en est pas moins celui dont les paroles sont les plus fortes. La réduction minimaliste de l’épaisseur psychologique et culturelle de l’œuvre d’art, la subordination de sa forme et de sa matérialité à des « concepts » préliminaires à l’œuvre même (incroyable retour à l’art de froide « exécution » contre quoi Stendhal s’était insurgé en la lointaine année 1824), le surfing « nomadique » à la surface de la toile, que nous avons hérité des deux décennies passées, n’ont pas encore laissé la place à un nouveau contexte artistique international.
Mais qu’importe, du moment que, dédaignant les ismes, des individualités singulières interrogent le monde et s’interrogent avec la liberté et l’intensité dont Christine Barbe fait preuve.
Antonio Del Guercio